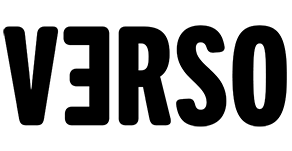par Véronique Baudoüin
Jeanne mène l’enquête
14/03/2025
Chapitre 1
On pourrait se croire dans un polar islandais : au fond d’un couloir sombre et silencieux, on pénètre dans une salle remplie d’armoires et de dossiers : ici les « cold cases » s’accumulent… Pas des crimes en série, heureusement ! Non, les mystères à élucider sont plutôt des attributions, des techniques ou des provenances à déterminer, car nous sommes au cœur du service de documentation du Musée lorrain. C’est ici que sont compilées toutes les informations réunies sur les collections- une tâche monumentale, jamais terminée… C’est aussi là que travaille Jeanne Huche.
Dans le ronronnement de son chauffage d’appoint, elle cherche et cherche encore. Elle ausculte et dissèque. Elle traque le moindre indice. Jeanne mène l’enquête depuis le mois de décembre 2024. Pourtant elle n’est pas détective, mais fraîchement diplômée d’un master 2 d’histoire de l’art de l’université Rennes 2. En service civique pour 7 mois, elle s’est lancée sur les traces des lorrains inconnus qui peuplent ces milliers de photos que conserve le musée. Sa mission : identifier, localiser, dater.
En passant par la Lorraine...
Un premier lot de 929 plaques photos à trier livre déjà ses secrets : un clocher d’église, des enfants qui réapparaissent à plusieurs reprises, un style de prise de vue… Jeanne classe, trie, regroupe. La voilà qui parcourt la Lorraine fin-de-siècle à dos de cheval ou en charrette : Vic-sur-Seille, Marville, Metz, les Vosges. Jeanne devient touriste par procuration.
Pas simple, quand on n’est pas soi-même lorraine, vous demandez-vous? Et si, justement, c’était pour Jeanne un avantage ? Sur ces images désespérément muettes, la chercheuse pose son regard aiguisé et intuitif. Elle déjoue les pièges d’inscriptions anciennes erronées, car on ne la lui fait pas, elle a de la méthode et vérifie tout ! Elle compare, encore et encore, avec d’autres photos, celles dont on connaît les auteurs, avec d’autres fonds, parcourt les collections de cartes postales, Limedia, Gallica, et survole la région avec G…gle Maps. Petit à petit, son regard s’affute et s’habitue : premières trouvailles, premiers rapprochements, et puis tout s’emballe et il ne reste plus que quelques photos qui n’ont pas encore livré leur secret. Alors Jeanne s’entête et s’acharne. Sa quête tourne à l’obsession. Ça peut durer des heures, des jours… On a envie de lui dire : « hé, Jeanne ! sors de là ! prends l’air ! », sauf qu’on est soi-même pris au piège de l’intrigue ! On voudrait à son tour percer le mystère, identifier cette belle maison au noble portail et donner un nom à ces visages inconnus.
Belle Époque?


Dans son exploration au microscope du passé imprimé dans la gélatine, Jeanne fait aussi des rencontres, dont certaines laisseront peut-être des traces persistantes. Ce sont ces jeunes enfants munis de pioches et de pelles qu’ils peuvent à peine soulever, photographiés au travail –forcé- dans le jardin d’une maison de redressement vers 1860. Autres temps, autres mœurs… Ou ces soldats chargé de déblayer les amas d’arbres et de gravats laissés par la rupture du barrage du réservoir de Bouzey en 1895, catastrophe qui fit près de 200 victimes. Elle croise sur sa route des centaines de visages : travailleurs, promeneurs, femmes, enfants, soldats… Son travail se mue en étude ethnologique, et dissèque des pans d’activités qui formaient le socle laborieux de la vie quotidienne : ces lavandières sont si souvent photographiées qu’elles paraitraient presque pittoresques ! Ce que la peinture impressionniste embellissait, la photographie pictorialiste en donne une version plus amère, car elle ne floute pas ces visages empreints de fatigue, de lassitude ou, pire, d’indifférence.
Rien pourtant qui ne semble entamer sa volonté. « Ils sont vivants ! Ils rient, ils jouent aussi ». Ouf ! Jeanne trouve aussi des raisons de se réjouir. Et repart vaillamment à la tâche, pour s’attaquer à un nouveau lot d’affaires non résolues !
Un chantier titanesque !
La collection de photographies anciennes conservée au Musée se compose de tirages sur papier des XIXeet XXesiècles ainsi que d’un ensemble exceptionnel de négatifs et positifs sur plaques de verre et supports souples. Celui-ci compte près de 11 000 objets (6 078 plaques de verre et 4 742 supports souples en plastique), dont essentiellement des négatifs destinés à la reproduction photographique sur papier ou sur verre. Datés des années 1860 pour les plus anciens, ils couvrent une période s’étalant jusqu’aux années 1960. Il s’agit pour la majeure partie de phototypes monochromes ayant une émulsion au gélatino-bromure d’argent, mais près de 650 plaques sont au collodion, procédé photographique dominant jusqu’aux années 1880. Dans le contexte de la rénovation du musée et du transfert des collections vers la réserve externe, une importante opération de conservation de ces matrices photographiques a été menée, ayant permis par la suite d’engager leur numérisation et leur informatisation. Le projet d’étude et de valorisation, mené par le service de documentation du musée, contribuera à présenter au public ces ressources, passionnant témoignage de la vie quotidienne en Lorraine durant près d’un siècle. Quelques notices sont déjà en ligne sur le site Internet du musée dans la rubrique « La Lorraine en images », et une carte interactive sur laquelle près de cent cinquante images raconteront Nancy à l’aube du XXe siècle y sera bientôt accessible..
La numérisation du fonds a bénéficié du soutien financier de la DRAC Grand Est.