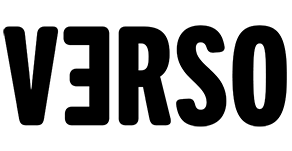Un musée en blanc ou en couleurs ?
27/03/2025
Le musée des Beaux-Arts s’est lancé depuis peu dans un projet de refonte muséographique de ses espaces d’exposition permanente. Dans ce remodelage en profondeur – du parcours et du discours – la couleur joue un rôle central. L’attention s’est portée dans un premier temps sur les salles du premier étage, avec le redéploiement des œuvres dans une vague de tonalités puissantes, allant du bleu pétrole au rouge lie-de-vin, en passant par le vert d’eau. Le musée a ensuite saisi l’opportunité d’importants travaux de toiture du pavillon XVIIIe pour étendre la couleur dans les salles du deuxième étage, « saint des saints » qui abrite les chefs d’œuvres de la Renaissance italienne et nordique. L’introduction de la couleur se fait au dépend du blanc immaculé, longtemps érigé en religion par la plupart des musées. Le blanc est encore traditionnellement utilisé pour présenter l’art contemporain mais il fait débat, notamment pour les salles de peinture ancienne.
Un éternel débat


La couleur a un impact important sur la perception visuelle et émotionnelle des œuvres d’art et sa présence sur les murs d’un musée ne va pas de soi. Elle suscite même parfois des réactions violentes. Le désaccord entre ses partisans et ses détracteurs se cristallise sur l’effet qu’elle produit : le « white-cube » (ainsi qualifie-t-on le type d’espace d’exposition qui prend la forme d’un grand cube sans fenêtre aux murs blancs) serait neutre, supprimant toute mise en contexte, alors que la couleur serait subjective en suggérant une époque ou un style, en inspirant une émotion ou un état d’âme. Dans les musées, l’alternance régulière de mise en blanc et de mise en couleur est-elle seulement un effet de mode, ou bien encore de préférence subjective – les « goûts et les couleurs ne se discutent pas ? C’est un peu plus complexe...
Plutôt Newton ?
Certains s’insurgent devant cette déferlante colorée sous prétexte que le musée est un lieu artificiel. Il doit donc rester le plus neutre possible. Enfant de la Révolution – en France tout au moins – il a été créé pour accueillir un rassemblement tout aussi artificiel d’œuvres qui, sorties de leur contexte initial, ont changé de signification. Voué au culte de l’art – le musée instaure une sorte de théologie de l’art – il devrait s’effacer complètement devant les œuvres. Pas question donc d’y introduire la couleur, joujou décoratif qui ne ferait qu’affirmer la présence de l’architecture et de l’environnement au dépend des œuvres, tout en exprimant l’égo des conservateurs. Le blanc exprimerait une posture d’humilité face à l’œuvre. Mais le musée est tout sauf un lieu neutre. Son architecture, qu’elle soit minimaliste ou baroque, impose discrètement un discours qui influe sur la perception des œuvres qu’elle accueille. La hauteur et le mode d’accrochage des toiles, l’éclairage, l’époque et le style des cadres (avec ou sans cadre d’ailleurs ?), la couleur (et quelle couleur ?), les cartels (quel récit ?)…, tout est signifiant, tout est affaire de choix et donc de mode (car les choix évoluent dans le temps). Il serait donc illusoire de croire que le blanc est neutre : cette non-couleur magnifie l’espace du musée, solennise les œuvres en leur conférant un environnement d’une clarté qui peut intimider. Défendre le blanc au nom du respect de l’œuvre n’a pas grand sens.




Le deuxième argument avancé par les tenants dogmatiques du blanc est d’ordre optique. L’apport de peinture colorée sur les murs modifierait, par effet de rémanence, la perception des couleurs constitutives des œuvres (c’est surtout vrai pour la peinture). Le blanc, lui, serait neutre, car il est pure lumière – depuis Newton on sait que la lumière naturelle est blanche. Un mur blanc ne contaminerait donc pas la lumière perçue par l’œil en renvoyant une réflexion bleue, rouge ou jaune dans la pièce. Autrement dit, présenté sur un mur bleu le savoureux aplat rouge de Rubens apparaîtra légèrement violet tandis que le manteau jaune d’or d’un prophète peint par Rembrandt prendra de discrètes nuances vertes. Un bleu cyan ou azur rendra la dorure d’un cadre plus présent et donc plus lumineux. Pourtant l’argument purement physique n’est pas non plus des plus pertinents car le blanc réfléchit toutes les longueurs d’ondes visibles de la lumière naturelle sans en absorber. Pour le dire simplement, le blanc éblouit. Son rayonnement, le halo de clarté qu’il crée autour de l’œuvre, empêche la révélation des contrastes de valeur parfois si subtils. Le blanc a donc tendance à éteindre les teintes et à assombrir. Pensons aussi que les peintures anciennes se sont souvent assombries avec le temps (les pigments vieillissent, les vernis jaunissent). Le blanc qui rayonne autour d’elle ne fait que les assombrir davantage. Le blanc comme la couleur ont leur part de subjectivité. Il suffit de faire un choix et d’assumer les parti pris qu’il suppose !
Ou plutôt Goethe ?
Mais alors se pose une question délicate : comment choisit-on la couleur ? Là encore, il n’y a pas de règle, il n’y a, au mieux, que des conventions et chaque musée fonde ses choix de manière individuelle. Les teintes des murs peuvent avoir une fonction contextuelle en venant suggérer l’époque de création et le lieu où les œuvres ont d’abord été appréciées, célébrées ou vénérées (église, cabinet de collectionneur, appartement princier, intérieur bourgeois, salon...). Les petites toiles des maîtres hollandais du Siècle d’or appellent forcément des ambiances et arrière-plans différents des grands formats de la peinture baroque italienne par exemple. Au musée des Beaux-Arts, le choix a été librement guidé par la théorie des couleurs de Goethe, énoncée dans un célèbre traité publié en 1810 (Farbenlehre). Dans un chapitre intitulé « Sur l’effet sensoriel et moral des couleurs » (Über die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben), Goethe s’oppose à la théorie physique développée par Newton et traite de la perception humaine des couleurs comme de leur réception. Derrière chaque couleur se cache une émotion, qui, elle-même, influe sur la perception des espaces et de leur usage. Il remarque par exemple que le rouge est actif, stimulant et noble, il pousse à l’action ; il faudrait donc plutôt le réserver aux salles cérémonielles (dans les musées, on l’associe souvent au luxe ostentatoire des salons de peinture du XIXe siècle). Le jaune confère lui une atmosphère joyeuse et légère, stimule l’échange et la conversation ; il est idoine pour les espaces collectifs comme les salles de compagnie, les salles à manger. Le bleu est froid, inspire le calme, la sérénité et la profondeur. Le vert est équilibré, à mi-chemin entre le jaune stimulant et le bleu apaisant, il est idéal pour la concentration et convient bien aux cabinets de travail ou aux chambres à coucher. C’est cette couleur que nous avons réservée aux petits formats nécessitant une attention soutenue du regard (natures mortes, paysages) tandis que le bleu tapisse les salles hautes sous plafond exposant les grands formats français et italiens.
La couleur a aussi une fonction didactique et spatiale, elle facilite l’orientation dans le musée, marque le rythme de la visite en évitant la monotonie, vient appuyer la signalétique pour mieux accompagner le public au sein des différents espaces : le bleu est associé aux grands formats baroques, le vert aux genres picturaux (natures, mortes, paysages…), le rouge au XIXe siècle. Les couleurs des murs aident donc le visiteur à s’orienter, dans le temps et dans l’espace (l’espace virtuel des œuvres comme celui bien réel de l’architecture du lieu). Habitués au zapping permanent des écrans dans une société ultra médiatisée et gouvernée par la tyrannie des réseaux sociaux, les visiteurs ne restent que quelques secondes tout au plus devant les œuvres. La couleur permet justement d’arrêter le regard, de structurer la déambulation. Et puis, tout en racontant une histoire, une belle mise en scène contribue tout bonnement au plaisir de la visite.